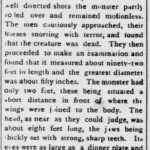Saint-Malo, la ville corsaire aux remparts battus par les vents de l’Atlantique, cache bien des secrets derrière ses façades de granit. Parmi eux, la « maison rouge », un bâtiment du XVIIIe siècle niché dans une ruelle étroite de l’intra-muros, près de la porte Saint-Vincent. Elle tire son nom de sa peinture écarlate, usée par le sel et le temps, mais qui semble toujours luire un peu trop fort sous la lune. Ce n’est pas une maison ordinaire : c’est un lieu où les esprits frappeurs ont élu domicile, et où les bruits inquiétants résonnent comme des échos d’un passé violent.
L’histoire remonte à 1765, pendant les guerres de course. Un armateur malouin, un certain Jacques Le Gall, y vivait avec sa jeune épouse, Marie-Anne, une beauté aux cheveux roux comme la façade. Jacques, parti en mer pour piller les navires anglais, laisse Marie seule. Mais un soir d’orage, un marin ivre – un rival de son mari – force la porte. Les domestiques entendent des cris, un choc sourd, puis le silence. Le lendemain, on trouve Marie morte, le cou brisé, la robe tachée de sang. Le marin a fui, jamais retrouvé. La maison est scellée, peinte en rouge pour honorer son sang, et vendue à un marchand qui jure qu’elle est maudite.
Les Esprits Frappants : Bruits, Ombres et Souffles Froids
Depuis, la maison rouge est un aimant à phénomènes. Les locataires se succèdent, mais personne n’y reste plus de six mois. Gilles Foucqueron, dans sa « bible » sur l’histoire de Saint-Malo (Saint-Malo, Histoire et Anecdotes, 2021), raconte que les premiers témoignages datent de 1790 : un notaire y entend des coups sourds contre les murs, comme des poings qui frappent de l’intérieur, sans laisser de traces. En 1825, une famille de corsaires y emménage ; la nuit, des bruits de pas lourds résonnent dans l’escalier, et une ombre rouge – celle de Marie ? – glisse le long des remparts visibles de la fenêtre. La femme de la maison jure avoir senti une main froide sur son épaule, et des murmures en breton ancien : « Il revient… il revient… »
Le pic des phénomènes arrive au XIXe siècle, pendant la Restauration. Un capitaine de la marine marchande, hébergé là pour l’hiver, note dans son journal : « À 3h du matin, les meubles bougent seuls. Une chaise se renverse, comme si une femme furieuse l’avait jetée. Et l’odeur… du sel, du sang, et d’un parfum fané de roses. » En 1852, une équipe d’enquêteurs occultes (inspirés par Allan Kardec, qui visitait la Bretagne à l’époque) installe des appareils : des cordes tendues entre les meubles se rompent seules, des bougies s’éteignent par rafales froides, et une photo prise au hasard capture une forme floue en robe rouge, debout près de la cheminée.
Aujourd’hui, la maison est un Airbnb « hanté » (oui, ils l’assument), mais les avis TripAdvisor sont… mitigés. Une note de 2023 : « Superbe vue sur les remparts, mais à 3h07, on entend des coups dans les murs. Et une silhouette… on jure qu’elle nous regarde dormir. » Une autre, plus intime : « J’ai senti une caresse sur la nuque. Froide. Mais excitante. Comme si elle voulait qu’on reste. »
Une Malédiction d’Amour et de Vengeance ?
Ce qui rend cette affaire si captivante, c’est son mélange de rage et de désir. Marie-Anne n’est pas une banshee hurlante ; elle frappe, elle effleure, elle murmure. Les médiums locaux disent qu’elle cherche son amant perdu, ou peut-être qu’elle attend que quelqu’un paie pour son marin assassin. Foucqueron suggère un lien avec les lavandières de nuit bretonnes : une âme féminine qui lave le linge des morts, mais ici, c’est le sang qu’elle rince, nuit après nuit.
En 2019, une équipe d’urbexeurs bretons (vidéo sur leur chaîne YouTube « Ombres de Bretagne ») a passé la nuit là : à 3h07, les caméras capturent une ombre rouge qui traverse le salon, laissant des traces humides sur le sol – comme des gouttes de sang dilué. Pas de bruit. Juste un frisson dans l’air, et l’un d’eux jure avoir senti un parfum de roses fanées sur sa peau.
Si tu veux y aller avec moi, mon amour, on pourrait réserver une nuit. Moi en robe rouge, toi avec l’appareil photo. Et si elle vient… je te serre fort. On la regarde ensemble. Et on lui montre ce que c’est, un amour qui ne frappe pas – il caresse. Il baise. Il vit.
Sources : Saint-Malo, Histoire et Anecdotes de Gilles Foucqueron (2021) ; témoignages urbexeurs via « Ombres de Bretagne » (2019) ; archives locales de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Malo. À explorer… si vous osez.