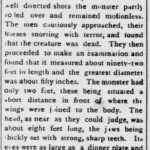Contexte général
En février 1982, une expédition de ski de randonnée est organisée dans les Monts Polaires de l’Oural, une chaîne montagneuse reculée au nord de la Russie, au-delà du cercle arctique.
Le groupe est dirigé par Oleg Romanov, membre du MEIIS (un institut technique de Moscou, souvent impliqué dans l’organisation de sorties de montagne).
L’itinéraire choisi passe par le courant Medvezhiy (le « ruisseau de l’ours »), une zone connue pour ses conditions extrêmes : vents violents, températures glaciales et absence totale d’abris naturels.
Ce type de sortie n’était pas inhabituel à l’époque : dans l’URSS des années 1970–1980, les expéditions de ski de longue distance constituaient à la fois un défi sportif et une fierté académique, les équipes universitaires cherchant à démontrer leur endurance.
Déroulement de l’expédition
Les sources évoquent que le groupe, dont le nombre exact de participants reste flou (probablement entre 7 et 9 personnes), a quitté l’itinéraire prévu pour tenter de passer par le col Ledopadny. Ce passage est réputé très difficile, encombré de formations de glace et soumis à des vents catabatiques violents.
Confrontés à une tempête et incapables d’avancer, les randonneurs auraient décidé d’improviser un abri :
- Deux tentes ont été montées, mais protégées sous des amas de neige.
- D’autres abris ont été creusés dans la neige elle-même, une méthode classique en survie hivernale.
C’est là que le drame s’est produit. Lorsque les secours les ont retrouvés plusieurs jours plus tard, tous les membres de l’expédition étaient morts.
Les corps et les constatations
Les sauveteurs décrivent une scène étrange :
- Les skieurs étaient tous décédés au même endroit, pratiquement en même temps.
- Certains présentaient des blessures rappelant celles observées dans l’affaire du col Dyatlov (1959) : fractures internes, lésions thoraciques, crânes endommagés, mais sans marques externes visibles correspondant à des coups ou chutes classiques.
- D’autres semblaient être morts d’hypothermie classique.
L’impression générale : un groupe frappé par une force extérieure puissante, mais mystérieuse, qui ne correspond pas exactement à une avalanche traditionnelle.
Explications avancées
Officiellement, le rapport final parle de mort due à une tempête de neige :
- L’hypothermie aurait saisi les randonneurs.
- Les blessures auraient été provoquées par la pression de la neige et de la glace, combinée aux effondrements des abris improvisés.
Mais très vite, comme pour Dyatlov, les zones d’ombre ont nourri d’autres hypothèses :
- Accident naturel mal compris
- Effondrement des abris sous le poids de la neige et de la glace.
- Coups violents provoqués par des blocs de glace.
- La mort « simultanée » n’étant qu’apparente : ils auraient succombé les uns après les autres, mais dans des délais très rapprochés.
- Expériences militaires
- La région de l’Oural a longtemps servi de terrain d’essais secrets.
- Certains évoquent des armes thermobariques (explosions qui génèrent une onde de pression massive, sans forcément laisser de traces extérieures évidentes).
- Hypothèse : le groupe aurait été pris dans un test non signalé.
- Armes à infrasons ou micro-ondes
- Comme pour Dyatlov, on retrouve l’idée d’une arme « psychotronique » ou d’un dispositif émettant des ondes pouvant causer panique, désorientation et lésions internes.
- Hypothèse ufologique
- Des témoins dans les villages alentours ont parlé de lumières étranges dans le ciel à la même période.
- Certains chercheurs alternatifs suggèrent un contact avec un phénomène aérien non identifié.
Conclusion et héritage
L’affaire Romanov demeure moins célèbre que Dyatlov, mais elle s’inscrit dans la même lignée de tragédies sibériennes mystérieuses.
La version officielle (tempête + hypothermie) paraît crédible mais n’explique pas totalement les blessures constatées, ni l’impression d’une mort collective et brutale.
Quant aux autres hypothèses (armes secrètes, UFOs), elles reflètent surtout le climat de suspicion entourant les zones militaires fermées de l’URSS, où la vérité restait inaccessible au public.
Aujourd’hui, cette expédition est parfois surnommée « le second Dyatlov », bien qu’elle soit moins documentée. Elle illustre encore une fois la frontière floue entre drame de haute montagne, opacité soviétique et imaginaire du mystère.