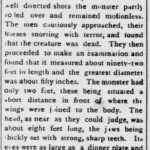En janvier 1962, dans un village reculé de la région de Tanganyika — aujourd’hui intégrée à la Tanzanie — un phénomène hors du commun fit son apparition. Dans une école de mission à Kashasha, plusieurs jeunes filles furent soudain prises d’une crise de fous rires incontrôlables. Rien d’exceptionnel à première vue… sauf que ces éclats d’hilarité se révélèrent impossibles à arrêter et se propagèrent comme une épidémie.
Ce qui commença par une poignée d’adolescentes gagna bientôt des centaines de personnes, paralysant la vie d’un village entier, puis de plusieurs localités. Ce curieux épisode allait entrer dans l’histoire sous le nom de l’épidémie de rires de Tanganyika.
Les débuts : un rire sans fin
Le 30 janvier 1962, trois jeunes élèves de l’école missionnaire de Kashasha se mettent à rire sans raison apparente. Leurs camarades, intrigués, finissent par être gagnés par le même éclat. Mais ce rire n’a rien de joyeux : il est nerveux, compulsif, parfois accompagné de pleurs, de cris, de convulsions légères.
Rapidement, près de 95 écolières sur 159 se retrouvent atteintes. Les cours deviennent impossibles, et l’école est contrainte de fermer au bout de quelques semaines.
Une contagion qui se propage
Loin de s’éteindre avec la fermeture de l’établissement, le phénomène se répand dans les villages voisins. Au total, plusieurs mois durant, des centaines de personnes — enfants comme adultes — connaissent ces crises de rires incontrôlés.
Les témoignages rapportent des attaques durant de quelques heures à plus de deux semaines, marquées par des spasmes, des évanouissements, des douleurs abdominales et une incapacité à mener une vie normale. Certaines localités touchées durent fermer écoles et lieux publics, tant la situation échappait à tout contrôle.
Une énigme pour la science
Comment expliquer une telle contagion de l’hilarité ? Plusieurs pistes ont été explorées :
1. Un cas d’hystérie collective
La plupart des chercheurs estiment aujourd’hui que l’épidémie de rires relève d’un phénomène psychogène collectif. Dans une société marquée par des tensions — le Tanganyika venait tout juste d’accéder à l’indépendance en décembre 1961 — le stress, l’incertitude et la pression sociale auraient trouvé une « sortie » dans ce trouble partagé.
2. Un contexte éducatif strict
L’école missionnaire de Kashasha, très rigide, pouvait accentuer la tension chez les adolescentes. Le rire, forme d’explosion nerveuse, aurait alors contaminé l’ensemble du groupe par effet d’imitation et de suggestion.
3. Des hypothèses médicales rejetées
Aucune cause biologique (virus, intoxication alimentaire, maladie neurologique) n’a été identifiée. Le caractère contagieux par simple proximité sociale a renforcé l’idée d’un trouble psychosocial plutôt que d’une infection.
L’impact et la mémoire du phénomène
L’épidémie dura environ 18 mois, touchant plusieurs centaines de personnes avant de disparaître aussi mystérieusement qu’elle était apparue.
Ce cas est aujourd’hui étudié dans les manuels de psychiatrie et de sociologie comme un exemple rare mais spectaculaire de trouble psychogène de masse.
Il illustre la puissance de l’esprit collectif : un rire devenu incontrôlable, se propageant tel un virus invisible, capable de mettre à l’arrêt une région entière.
Un mystère entre science et folklore
Si les spécialistes rangent cet épisode dans la catégorie des phénomènes psychosociaux, il conserve une aura énigmatique. Comment un simple rire a-t-il pu se transformer en vague paralysante, bouleversant la vie de villages entiers ?
Dans l’imaginaire local, l’épidémie a parfois été interprétée comme une malédiction, une punition divine, ou une manifestation surnaturelle liée au passage à l’indépendance.
Entre crise nerveuse collective et légende, l’affaire de Tanzanie rappelle combien la frontière est mince entre le psychologique et le mystérieux, entre le corps et l’invisible.