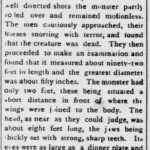Quand une jeune femme devient l’instrument de la mort
« Elle les séduisait, les attirait, et les livrait à la mort. »
Tels étaient les mots employés par la presse française en 1984 pour qualifier Valérie Subra, une adolescente de 18 ans devenue le visage d’une affaire criminelle qui allait hanter la mémoire collective. Une affaire dans laquelle les fantasmes, la manipulation et la fascination du mal se mêlent au sang, jusqu’à faire d’elle une figure quasi-mythique : celle d’une succube moderne, à la croisée des archétypes médiévaux et des tragédies urbaines contemporaines.
Contexte : Paris, années 1980
Le drame se déroule dans un Paris crépusculaire, en ce début des années 1980, où la jeunesse désœuvrée erre entre les marges sociales, les rêves de grandeur et la violence. Le trio formé par Valérie Subra, Jean-Rémi Sarraud et Laurent Hattab évolue dans cet univers interlope. Tous trois sont jeunes, issus de milieux instables, et cherchent par tous les moyens à échapper à la médiocrité de leur quotidien.
Mais l’itinéraire qu’ils empruntent ne les mènera pas vers l’émancipation. Il les propulse au cœur d’un fait divers sanglant, où la beauté d’une jeune femme devient une arme, où le sexe sert d’appât, et où la mort attend au bout de la route.
Le stratagème : l’appât sexuel comme piège
Valérie Subra a 18 ans. Elle est belle, elle est rebelle, et elle devient rapidement le pivot d’un plan macabre. Elle joue le rôle de ce qu’on appellera bientôt l’Appât. L’idée est simple, presque diabolique dans sa simplicité : séduire un homme, lui proposer un rendez-vous galant, et le conduire dans un lieu isolé où ses deux complices l’attendent pour le dépouiller, ou pire.
Le 25 mars 1984, leur première victime est attirée de cette manière. Un homme d’affaires nommé Jean-Michel Bissonnet est retrouvé assassiné, tué de plusieurs coups de couteau. D’autres suivront. Le trio recommence, avec toujours la même méthode. Valérie charme, rassure, hypnotise. Elle incarne la promesse de l’étreinte, la douceur, le plaisir… Mais elle livre ses proies à la violence de ses deux complices.
Le mobile ? Le trio cherche de l’argent. Ils projettent de partir à l’étranger, de changer de vie. Le meurtre devient alors un moyen, banal, froid, dépourvu d’émotion, dans leur esprit.
L’arrestation et le procès : la chute de la succube
Leur parcours criminel prend fin lorsque la police les identifie et les arrête après un troisième meurtre. La presse s’empare de l’affaire. Mais très vite, ce n’est pas Hattab ou Sarraud qui captivent l’opinion publique : c’est Valérie Subra. Son visage s’étale à la une des journaux. Son rôle trouble, à la fois victime et bourreau, fascine autant qu’il horrifie.
Lors du procès, elle déclare avoir été manipulée. Elle affirme que ses complices, plus âgés, plus violents, l’ont utilisée. Pourtant, certains témoignages et éléments du dossier démontrent sa pleine participation, son calme, voire sa froideur dans l’exécution du plan. Elle reconnaît les faits mais reste insaisissable : nymphe ? complice passive ? meurtrière consciente ?
La justice tranche : elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Ses deux complices sont condamnés à la perpétuité. Valérie Subra, après avoir purgé sa peine, sortira discrètement de prison des années plus tard.
La fascination du mal : Valérie Subra, figure de la succube moderne
Pourquoi cette affaire marque-t-elle autant les esprits ? Pourquoi Subra est-elle devenue une légende noire ?
Il faut ici convoquer les archétypes. Dans l’imaginaire collectif, Valérie Subra incarne une succube moderne : une femme jeune, belle, séductrice, qui conduit les hommes à leur perte. Comme les succubes médiévales qui apparaissaient dans les rêves pour voler l’énergie vitale des hommes, Subra hante les nuits de ceux qui la croisent. Elle transforme l’amour en arme, le désir en piège, le plaisir en agonie.
Cette association a été largement alimentée par les médias : on parle de « regard de glace », « d’ange noir », de « beauté fatale ». Elle devient l’archétype du danger sexuel féminin, figure profondément ancrée dans les mythes patriarcaux et les récits criminels. Une Éve démoniaque, une Lilith contemporaine.
Réception médiatique et adaptation cinématographique
L’affaire a eu un tel impact qu’elle a inspiré le film « L’Appât » (1995) de Bertrand Tavernier, qui transpose l’histoire à l’époque contemporaine. Le film évite le sensationnalisme, mais ne fait pas l’économie du malaise que suscite cette jeune femme qui tue sans état d’âme.
Dans une société où le crime féminin fascine encore plus que le crime masculin, Valérie Subra reste une figure d’exception : ni sorcière, ni sainte, ni victime, mais une sorte de miroir obscur tendu à notre propre imaginaire collectif.
Conclusion : L’ombre de la tentation
L’affaire Subra est plus qu’un fait divers. Elle est le reflet d’une société qui projette ses peurs sur le féminin : peur du désir, de la trahison, de la manipulation. En cela, Valérie Subra incarne une figure ancienne, transmise par les mythes et recyclée par les médias : celle de la succube, prédatrice invisible de l’âme masculine.
Mais derrière le mythe, il y a aussi une réalité sordide, une jeunesse brisée, une spirale de violence, et la banale mécanique du crime. Le visage de Valérie Subra continue d’habiter les mémoires, non pas seulement pour ce qu’elle a fait, mais pour ce qu’elle représente : une énigme, une transgression, une incarnation moderne de la mort désirée.
Souhaites-tu que je l’adapte avec des illustrations ou une mise en page prête à publier sur ton site Mysterium Incognita ?