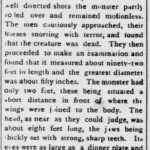L’Inde regorge d’histoires où la frontière entre le visible et l’invisible s’efface. Mais rares sont celles qui ont troublé à la fois les familles, les prêtres et les chefs d’État.
Dans les années 1930, à Delhi, une enfant de quatre ans, Shanti Devi, se met à raconter avec calme et précision une existence qu’elle n’a jamais vécue : celle d’une jeune femme nommée Lugdi Devi, morte en couches dans une autre ville. Ce récit, loin d’être un simple fantasme d’enfant, deviendra une affaire nationale et attirera l’attention du Mahatma Gandhi lui-même.
Comment une fillette issue d’une famille ordinaire a-t-elle pu décrire, avec une exactitude déconcertante, des lieux et des personnes qu’elle n’avait jamais rencontrés ?
L’histoire de Shanti Devi demeure l’un des cas les plus fascinants et documentés de réincarnation présumée du XXᵉ siècle.
Les premiers souvenirs : la petite fille qui disait s’appeler autrement
Shanti naît à Delhi en 1926. Ses parents, pieux et discrets, mènent une existence sans histoire jusqu’à ce que leur fille, à peine âgée de quatre ans, commence à parler d’un mari, d’une maison à Mathura et d’un enfant qu’elle aurait perdu.
Le ton est grave, presque adulte. L’enfant ne semble pas « jouer ». Elle répète que son vrai nom est Lugdi Devi, qu’elle est morte peu après avoir donné naissance à un fils, et que son mari s’appelait Pandit Kedarnath Chaubey.
Ses parents, d’abord amusés, s’inquiètent lorsqu’elle décrit avec précision des lieux qu’elle n’a jamais visités : le temple de Dwarkadhish, les marchés animés de Mathura, et les couloirs d’une maison blanche qu’elle affirme avoir habitée.
Un détail frappe : elle évoque une blessure à la gorge ressentie comme une douleur physique. Or, Lugdi Devi, l’épouse du commerçant Kedarnath, était effectivement morte après une césarienne compliquée, quinze ans auparavant.
L’enquête : quand la mémoire défie la distance
La nouvelle finit par se répandre dans le quartier. Des curieux viennent l’interroger, des érudits hindous s’en mêlent.
Un enseignant, troublé par les propos de Shanti, décide de vérifier l’existence de la famille Chaubey à Mathura. La réponse ne tarde pas : le mari de Lugdi, bien vivant, confirme les faits. Intrigué, il accepte de venir rencontrer l’enfant.
La scène est restée célèbre. À l’arrivée de l’homme, Shanti, sans la moindre hésitation, baisse les yeux et murmure :
« Tu es venu, Kedarnath. »
Elle se souvient de son caractère, de ses habitudes, des objets de leur ancienne maison. Elle lui reproche même d’avoir manqué à une promesse faite sur son lit de mort. Devant témoins, elle identifie des membres de sa famille passée et décrit des détails intimes de leur vie commune.
Face à ce déferlement de souvenirs précis, une commission d’enquête indépendante est constituée, avec des juges, des érudits et même des journalistes. Parmi eux, un certain Mahatma Gandhi, qui suit l’affaire avec attention.
Les conclusions : un mystère que même Gandhi n’a pas su trancher
Les enquêteurs accompagnent Shanti à Mathura. Dès son arrivée, elle reconnaît les ruelles, les temples, la maison, le quartier. Elle s’y déplace sans hésitation, guidant le cortège avec l’assurance de quelqu’un qui revient chez soi.
Elle s’adresse spontanément à des voisins en les appelant par leur prénom, identifie le lit où elle serait morte, et décrit les changements apportés depuis sa disparition.
Dans son rapport, la commission reconnaît que l’enfant possédait des connaissances impossibles à expliquer par des moyens ordinaires. Gandhi, tout en demeurant prudent, admet que le cas pose une question spirituelle profonde sur la continuité de la conscience après la mort.
La portée spirituelle : entre foi, science et mémoire du monde
Pour les bouddhistes et hindous, le cas Shanti Devi est une confirmation éclatante du cycle des renaissances, le samsara. L’âme, disent-ils, conserve la mémoire des émotions les plus fortes, surtout lorsqu’elle quitte la vie dans la douleur.
Les scientifiques occidentaux, eux, restent plus sceptiques. Certains psychologues évoquent la possibilité d’un cryptomnésie — un souvenir inconscient d’informations entendues sans en avoir conscience. D’autres, comme le Dr Ian Stevenson de l’Université de Virginie, verront dans l’affaire une preuve sérieuse de réincarnation spontanée, puisqu’elle fut observée, vérifiée et documentée publiquement, sans médiation religieuse ni régression hypnotique.
Épilogue : la paix retrouvée
Devenue adulte, Shanti Devi a vécu simplement, sans jamais chercher la gloire. Elle s’est mariée, a eu une vie ordinaire, et refusait de tirer profit de son histoire.
Elle affirmait seulement avoir été « deux personnes à la fois », et considérait son cas comme une preuve d’amour continu au-delà des corps.
Elle s’est éteinte en 1987, paisiblement.
Son nom reste associé à l’un des cas les plus solides et troublants de mémoire transpersonnelle jamais recensés.
Conclusion : la mémoire de l’âme
L’histoire de Shanti Devi laisse une empreinte indélébile dans la quête humaine du sens.
Si la réincarnation demeure un mystère, ce cas rappelle que certaines âmes semblent refuser l’oubli, comme si la vie, en se prolongeant d’un corps à l’autre, cherchait à réparer, à comprendre, à se souvenir.
Et si, finalement, la mort n’était qu’un passage — une porte entrouverte sur le souvenir d’un autre soi ?