Parmi les nombreuses disparitions et catastrophes qui jalonnent l’histoire des expéditions soviétiques en milieu hostile, l’affaire du groupe de Kuznetsov occupe une place particulière. Si le public connaît surtout l’énigme du col Dyatlov (1959), d’autres épisodes tragiques, moins médiatisés, se sont déroulés dans les paysages glacés de l’Union soviétique. En 1973, dix jeunes skieurs de Samara, menés par Mikhail Kuznetsov, se lancèrent dans une traversée ambitieuse de la péninsule de Kola. Leur périple s’acheva dans le drame, au cœur de la toundra du Lovozero, et soulève encore aujourd’hui de nombreuses questions.
La composition du groupe et l’itinéraire prévu
Mikhail Kuznetsov, alpiniste expérimenté et passionné de ski de fond, avait rassemblé autour de lui neuf compagnons, tous originaires de Samara (à l’époque Kouïbychev). L’équipe comptait des hommes et des femmes jeunes, formés physiquement, avides d’aventure et désireux de repousser leurs limites dans le nord extrême.
Leur objectif : traverser les vastes étendues enneigées de la péninsule de Kola en plein hiver, parcourir la toundra sauvage du Lovozero, franchir le col d’Elmorayok, atteindre le lac sacré Seydozero — lieu chargé de légendes lié aux Sami et aux récits mystiques — avant de continuer leur itinérance vers les montagnes voisines. L’expédition s’annonçait exigeante, mais faisable pour une équipe bien équipée et expérimentée.
Le déroulement tragique
Dès les premiers jours, les conditions météorologiques se dégradèrent brutalement. Le vent se mit à souffler avec une violence extrême, soulevant la neige en rafales aveuglantes, tandis que le thermomètre plongeait à des températures mortelles. Les skieurs furent contraints de ralentir leur progression.
À un moment critique, le groupe prit une décision qui s’avérera fatale : au lieu de dresser leur tente pour se protéger des éléments, ils choisirent de simplement l’étendre sur la neige et de s’abriter dessous, exposés aux bourrasques. Était-ce par fatigue, par manque de visibilité, ou par une mauvaise interprétation de la situation ? On ne le saura jamais.
Les jours suivants, l’équipe se divisa. Certains partirent en reconnaissance, d’autres restèrent à proximité du campement improvisé. La cohésion du groupe s’effrita peu à peu, tandis que la tempête continuait de les harceler sans répit.
Les corps furent retrouvés progressivement. Certains étaient étendus à quelques centaines de mètres seulement du lieu du bivouac, incapables de regagner le camp malgré la courte distance. D’autres furent découverts beaucoup plus loin, éparpillés dans la toundra, comme s’ils avaient tenté désespérément de fuir l’endroit ou de chercher une échappatoire. Le leader, Mikhail Kuznetsov, gisait à l’écart, figé dans la neige. Tous avaient succombé au froid et à l’épuisement.
Les zones d’ombre
Officiellement, la conclusion des enquêteurs fut simple : une tempête de neige exceptionnelle, des conditions extrêmes, et une erreur de jugement ayant entraîné une issue fatale. Pourtant, certaines incohérences demeurent.
Pourquoi le groupe choisit-il de ne pas ériger correctement la tente, alors que tout alpiniste sait que c’est un abri vital contre le vent et le froid ? Pourquoi se séparer dans une telle situation, alors que la survie dépendait de l’unité ? Qu’est-ce qui a poussé des skieurs expérimentés à multiplier les erreurs fatales ?
Ces questions hantent les récits de l’affaire Kuznetsov. Était-ce uniquement la fatigue et la désorientation qui ont mené à ces décisions absurdes ? Ou bien faut-il envisager une panique collective, un effondrement psychologique sous l’effet conjugué de la faim, du froid et du vent ?
Certains amateurs de mystères, sensibles à l’aura étrange du lac Seydozero et aux légendes chamaniques du peuple Sami, vont jusqu’à suggérer qu’une influence « extérieure » — qu’elle soit psychologique ou surnaturelle — aurait pu troubler l’esprit des randonneurs. Ces hypothèses restent évidemment invérifiables, mais elles alimentent la persistance du mystère.











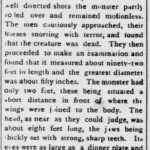



[…] Le drame du groupe de Kuznetsov : une tragédie oubliée de la péninsule de Kola (1973) […]