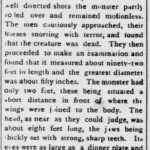Parmi les récits étranges qui circulent dans l’ombre du web et des forums d’horreur, celui-ci retient l’attention : une série de meurtres lors desquels des cartes à jouer classiques — marquées du simple mot « Alice » — auraient été laissées en guise de signature. Le symbole interpelle : pourquoi une carte, pourquoi ce nom ? La légende dégage un malaise qui va au-delà du fait divers : elle touche au jeu, au hasard, à l’identité. Cet article s’attache à présenter ce récit, à en analyser les zones d’ombre, et à proposer des pistes de lecture pour ce qu’il révèle de nos peurs et de nos croyances.
Le récit de la légende
Le cœur de la légende est simple mais frappant : un tueur (ou des tueurs) laisse sur la scène d’un crime une carte à jouer ordinaire — pique, cœur, trèfle ou carreau — mais sur laquelle, au lieu du motif classique, est inscrite ou griffonnée « Alice ». Le nom paraît écrit au sang, ou du moins d’une manière dramatique. Le symbole devient signe : l’identité « Alice » devient l’ultime message laissé à la victime ou à l’enquêteur.
Ce type de «carte de visite» (calling card) dans les récits criminels n’est pas inédit : certains tueurs laissent des objets, des symboles, des inscriptions mystérieuses pour sidérer ou signifier. Mais dans ce cas, la légende mêle cartes, inscription « Alice », meurtre et parfois atmosphère de conte inversé.
Selon les versions, le nombre de cartes peut varier, le lieu reste souvent indéterminé, et aucun dossier public fiable n’a été retrouvé pour confirmer l’affaire telle quelle.
Analyse des sources et de la vérification
Une enquête documentaire-légère a été menée : aucune archive judiciaire identifiée, aucun article de presse crédible ne mentionne explicitement « cartes classiques avec le mot Alice» comme signature d’un meurtre. Les traces existantes renvoient principalement à des récits de type «creepypasta» (fiction-hommage à l’horreur virale) plutôt qu’à des dossiers criminels établis.

Pourquoi cette légende fascine ?
- Le support « carte à jouer » : un objet ordinaire, banal, tiré du quotidien – transformé en instrument de terreur et de symbole. Le contraste entre “jeu” et “meurtre” crée un frisson.
- Le nom « Alice » : évoque l’innocence, le rêve, la chute dans l’imaginaire (on pense à la figure d’Alice dans Pays des Merveilles). L’inscrire sur une carte de mort renverse cette symbolique.
- L’effet « signature invisible » : un meurtre non élucidé, un message cryptique, un tueur qui joue avec le symbole. Cela nourrit l’imaginaire collectif et l’angoisse que “quelque chose de non-dit” rôde.
- Le flou des faits : absence de localisation précise, de noms, de dates. Le récit vit par retransmission, variation, amplification. C’est typique des légendes urbaines qui se nourrissent d’ombre.
Conclusion
La « l’affaire des cartes « Alice » » demeure une zone grise : ni factuelle au sens strict, ni totalement fictive — plutôt un récit liminal, entre rumeur, métaphore et plausible. Elle offre cependant un miroir puissant : celui de notre rapport aux objets, aux signes, et à la violence silencieuse.