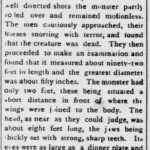Une institution pionnière, une dérive trouble
L’Institut Allan Memorial, annexe psychiatrique de l’hôpital Royal Victoria affilié à l’Université McGill, est devenu le théâtre d’expérimentations psychologiques aussi extravagantes qu’effroyables, entre 1957 et 1964 (voire dès 1948).
Le protagoniste : Donald Ewen Cameron et sa méthode de “psychic driving”
Donald Ewen Cameron, psychiatre écossais de formation, dirigeait l’Institut et développait une technique dite de “psychic driving” : il cherchait à effacer la mémoire des patients, puis à les soumettre à une reprogrammation mentale.
Protocoles expérimentaux : un cocktail de souffrance
Les traitements comprenaient :
- Sommeil artificiel prolongé, parfois jusqu’à 86 jours, grâce à des neuroleptiques comme la chlorpromazine.
- Électrochocs intensifs, considérablement plus puissants que la norme.
- Déprivation sensorielle, parfois avec paralysants comme le curare, dans des caissons isolants.
- Messages enregistrés, diffusés en boucle des heures durant — souvent des phrases simples visant à reprogrammer la pensée.
- Administration de LSD, visant à faciliter un “remodelage mental”.
La CIA finança ces expériences via une organisation écran appelée Human Ecology Fund, attribuant environ 19 000 USD par an à l’Institut entre 1957 et 1963 (sous-projet 68). Le gouvernement canadien apporta aussi des financements.
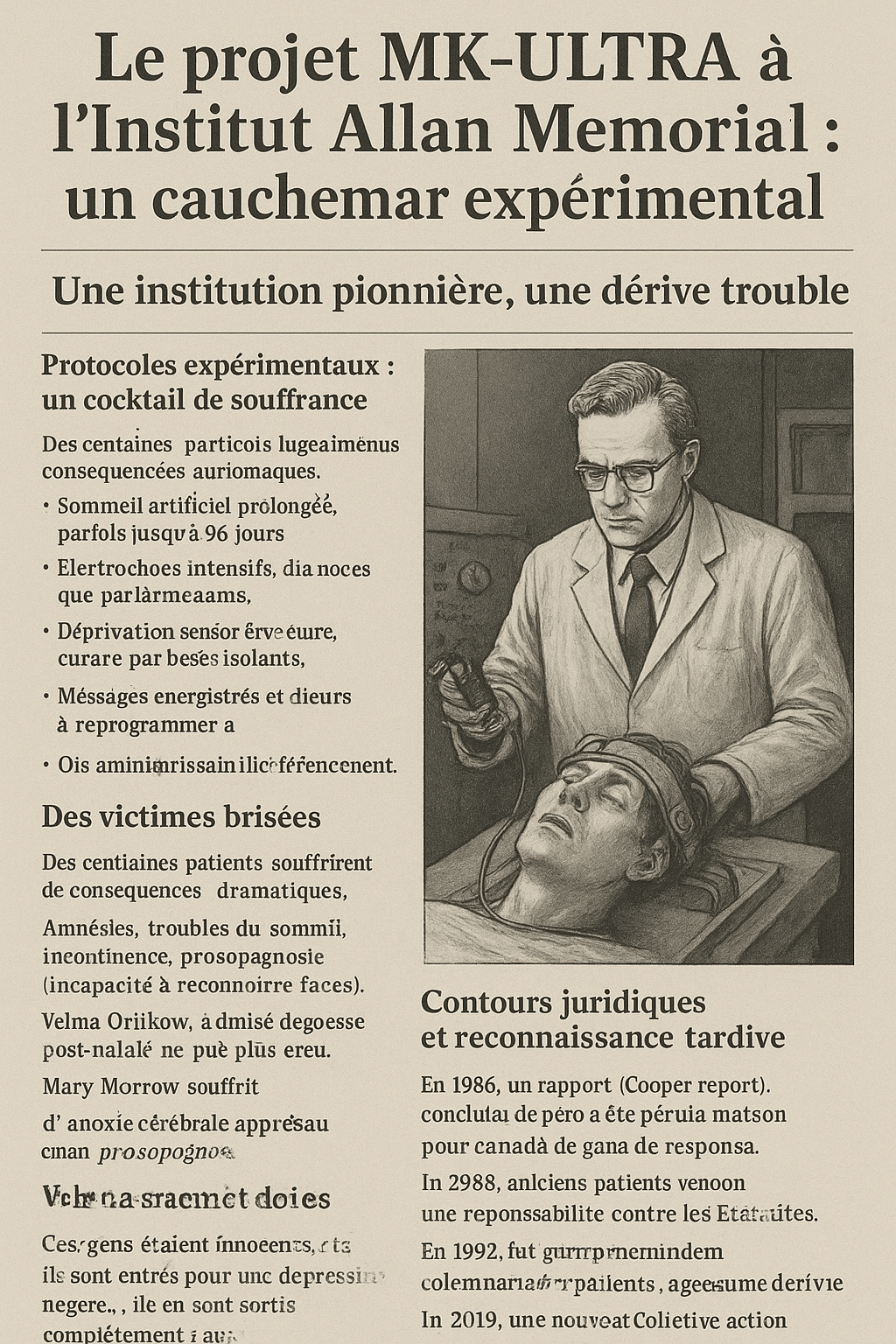
Des victimes brisées
Des centaines de patients souffrirent de conséquences dramatiques : amnésies, troubles du sommeil, incontinence, prosopagnosie (incapacité à reconnaître les visages), altérations cognitives ou émotionnelles majeures. Velma Orlikow, admise pour dépression post-natale, ne put plus lire ou écrire. Mary Morrow souffrit d’anoxie cérébrale après électrochocs et devint prosopagnosique.
Certains témoignages décrivent l’expérience comme une tentative d’« effacement de l’âme ».
Contours juridiques et reconnaissance tardive
En 1986, un rapport (Cooper Report) conclut que le Canada n’avait aucune responsabilité morale ou légale, arguant que la CIA aurait financé les recherches sans les diriger.
En 1988, d’anciens patients remportèrent une action collective contre la CIA, obtenant des compensations d’environ 67 000 USD chacun. En 1992, le gouvernement canadien indemnisait 77 patients d’environ 100 000 USD — mais conditionnels à des accords de confidentialité.
En 2019, une nouvelle action collective a été intentée contre le gouvernement canadien, McGill et la CIA. Mais la Cour d’appel du Québec a statué que les États-Unis bénéficiaient d’immunité souveraine — un jugement confirmé par la Cour suprême, qui a refusé d’entendre l’appel en 2024. Les plaignants soulignent que la loi de 1982 sur l’immunité de l’État rend possible des poursuites pour blessures corporelles rétroactives — mais l’immunité reste confirmée.
Paroles du terrain
« Ces gens étaient innocents ; ils sont entrés pour une dépression légère… ils en sont sortis complètement ravagés et leur vie ruinée. » — Marlene Levenson, nièce d’une victime
L’ombre du silence
Dossiers détruits, accords silencieux, témoignages muselés : la mémoire de ces victimes a souvent été étouffée. Des ONG comme SAAGA (Survivors Allied Against Government Abuse) continuent à réclamer justice et reconnaissance.
Panorama synthétique
| Élément | Détail |
|---|---|
| Lieu & période | Institut Allan Memorial, Montréal (1957–1964, voire dès 1948) |
| Responsable | Dr Donald Ewen Cameron, psychiatre |
| Techniques | Sommeil artificiel, électrochocs intensifs, déprivation sensorielle, messages en boucle, LSD |
| Financement | CIA (Human Ecology Fund), gouvernement canadien |
| Victimes | Centaines, séquelles graves, actions en justice |
| Reconnaissance | Compensations (1988, 1992), action collective récente, immunité légale pour les États-Unis |